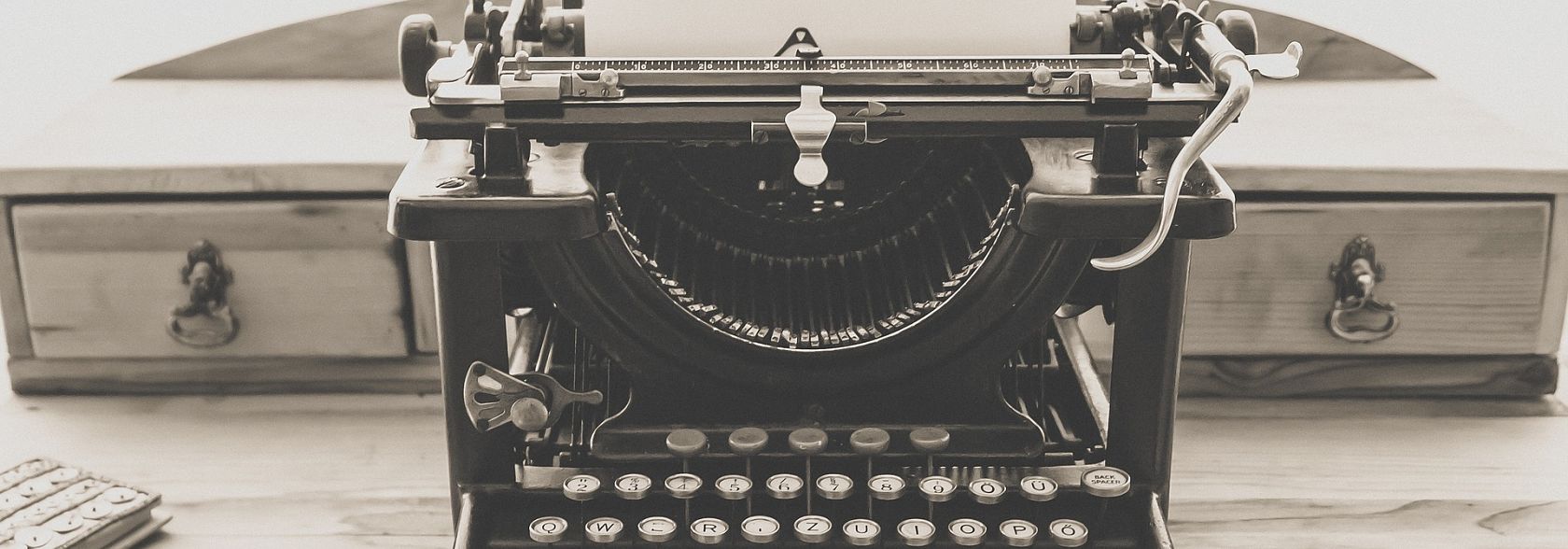Soutenance de thèse - Abader ALI-GUIBA IBRAHIM
Soutenance de thèse - Abader ALI-GUIBA IBRAHIMAbader ALI-GUIBA IBRAHIM, en vue de l’obtention du grade de Docteur en Arts, Lettres et Langues Spécialité : LANGUES, LITTÉRATURES FRANÇAISES, LITTÉRATURES FRANCOPHONES (3L2F) présentera ses travaux intitulés : « L’insécurité linguistique dans les pratiques langagières des lycéens djiboutiens. » le 11 juillet à Lorient.
Date 11/07

Résumé
L’insécurité linguistique dans les pratiques langagières des lycéens djiboutiens.
Notre travail de recherche propose une réflexion sur le phénomène de l’insécurité linguistique dans les pratiques langagières des lycéens en contexte scolaire à Djibouti. Il s’intéresse à un champ de recherche très fertile et pourtant peu investi dans le domaine francophone (Feussi et Lorilleux 2020). Cette recherche, qui s’inscrit dans une perspective sociolinguistique et didactique, découle de notre expérience qui nous a permis d’observer une baisse généralisée du niveau des élèves en français de nos jours, laquelle se traduit, entre autres, par une insécurité linguistique, c’est-à dire un sentiment d’inconfort qui intervient chez tout locuteur en raison de la perception généralement erronée de sa façon de parler (accent ou prononciation) au regard des normes socialement légitimées (Labov 1976), d’une conscience normative accrue (Francard 1993) ou d’une maitrise partielle et insuffisante de la langue.
Ce phénomène ne concerne pas uniquement les jeunes, mais peut aussi être vécu par des personnes d’autres âges. Ce travail essaie d’identifier les facteurs de l’insécurité linguistique chez des lycéens de nos jours et de contribuer à une meilleure compréhension de ce phénomène qui, jusqu’à présent, n’a pas fait l’objet d’une recherche universitaire en contexte djiboutien. Il s’agit d’appréhender les contours de ce concept au caractère flou et multidimensionnel, marqué par une indéfinition persistante depuis son émergence (Bavoux 1996) et une forte instabilité théorique et méthodologique (Bretegnier 1996). Pour mener à bien notre étude, nous avons élaboré un protocole d’enquête qui repose sur une approche essentiellement qualitative et intègre les apports de la sociodidactique (Rispail 2005) et de l’ethno-sociolinguistique de la complexité (Blanchet 2012). Il s’appuie sur les représentations sociolinguistiques des élèves, leurs discours épi- et métalinguistiques ainsi que sur des considérations liées à la norme linguistique en jeu à l’école.
Sur le plan quantitatif, nous avons proposé un questionnaire sociolinguistique à destination des lycéens de cinq établissements secondaires de Djibouti, avec un échantillon estimé à 700 élèves. Pour la partie qualitative, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès des élèves et mené des observations directes sur leurs pratiques langagières, afin d’identifier les manifestations discursives, affectives et comportementales de l’insécurité linguistique, et les stratégies de contournement employées. Nous avons également administré en ligne un questionnaire destiné aux enseignants de français afin de recueillir leurs points de vue sur les problématiques scolaires, directement.
Mot clés : insécurité linguistique, norme linguistique, représentations sociolinguistiques, discours épilinguistique et métalinguistique.
Abstract
Linguistic insecurity in the language practices of Djiboutian high school students.
Our research proposes a reflection on the phenomenon of linguistic insecurity in the language practices of high school students within the educational context of Djibouti. It focuses on a fertile area of research that remains largely unexplored in the Francophone domain (Feussi and Lorilleux, 2020). This study, situated within a sociolinguistic and didactic framework, stems from our observations of a widespread decline in students' proficiency in French, which today manifests, among other things, as linguistic insecurity — that is, a feeling of discomfort experienced by speakers due to their often erroneous perception of their way of speaking (accent or pronunciation) in relation to socially legitimized norms (Labov, 1976), heightened normative awareness (Francard, 1993), or partial and insufficient mastery of the language. This phenomenon affects not only young people but can also be experienced by individuals of all ages.
The present study seeks to identify the factors contributing to linguistic insecurity among high school students and to contribute to a better understanding of this phenomenon, which until now has not been the subject of academic research in the Djiboutian context. It aims to clarify the contours of this concept, characterized by its vague and multidimensional nature, persistent lack of definition since its emergence (Bavoux, 1996), and considerable theoretical and methodological instability (Bretegnier, 1996).
To carry out this research, we developed a research protocol based primarily on a qualitative approach, incorporating contributions from sociolinguistics (Rispail, 2005) and ethno-sociolinguistic complexity (Blanchet, 2012). The study draws on students' sociolinguistic representations, their epi- and metalinguistic discourses, as well as on issues related to the linguistic norm operating within the school context. On the quantitative side, we administered a sociolinguistic questionnaire to high school students from five secondary schools in Djibouti, with a sample of approximately 700 students. For the qualitative component, we conducted semi-structured interviews with students and carried out direct observations of their language practices to identify the discursive, affective, and behavioral manifestations of linguistic insecurity, as well as the avoidance strategies they employ. Additionally, we administered an online questionnaire to French teachers to gather their views on school-related issues directly or indirectly linked to our research topic.
Keyword: Linguistic insecurity, linguistic norm, sociolinguistic representations, epilinguistic and metalinguistic discours.
Membres du jury
- Pr Nathalie GARRIC, rapporteur, Professeure des Universités, Université de Nantes, PREFics UR7469
- Pr Aura Luz DUFFÉ MONTALVÁN, rapporteur, Professeure des Universités, Université Paris Nanterre, CRIIA UR 369
- Pr Maria Immaculada FÀBREGAS-ALÉGRET, directrice de thèse, Professeure des Universités, Université Bretagne Sud, HCTI UR 4249
- Dr Mohamed Ismail ABDIRACHID, membre du jury, Maître de Conférences, Université de Djibouti
- Pr Mercè PUJOL BERCHÉ, membre du jury, Professeure des Universités Émérite, Université de Perpignan Via Domitia
Informations pratiques
Vendredi 11 juillet à 14h30
Auditorium de la Maison de la Recherche
Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
Lorient
Pour assister à la soutenance à distance
Crédit photographique : ©Université Bretagne Sud. Service Communication